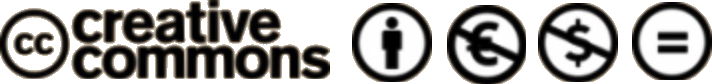Le cimetière de la psychiatrie est une particularité peu connue, peu de cimetières de ce type persistent en France. Le site de Cadillac (Gironde) avec l’aide de la région a fait l’objet d’une restauration et d’une valorisation ( voir : Une seconde vie pour le cimetière des oubliés) et d’une inscription aux monuments historiques en 2010, le cimetière et l’hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère) font également l’objet d’une inscription MH en 2023.
Le cimetière de Mayenne est installé en 1878 à l’est de la ville sur l’extrémité sud-ouest du champ de la Baudrairie [1] sur 4500 m² environ, proche de la voie de chemin de fer, il reste actif jusque dans les années 2000, la dernière date portée sur une stèle est 2017 mais une des dernières inhumations est celle du docteur Fellion en 1989, médecin-directeur de 1950 à 1974 et médecin -chef jusqu’en 1980, les cendres de son épouse ont rejoint sa tombe en 2017.
Le terrain au départ est loué par l’asile qui en fait l’acquisition en 1888. La date de 1878 figure sur le socle de la croix de cimetière en granit, la croix est entourée par le carré des sœurs, tombes de religieuses (les sœurs de la Charité d’Evron) qui travaillaient à l’asile jusqu’en 1990. Elles sont signalées par un cœur en émail portant une ou plusieurs dates car plusieurs religieuses peuvent partager un même emplacement.
Il accueille les tombes des aliénés puis des patients de l’établissement non réclamés par les familles mais aussi du personnel, infirmiers, médecins et aumôniers.
Situé derrière le centre social il est ouvert au public. Sa conservation passe par la reconnaissance de ce site comme patrimoine.
Les archives du cimetière entre 1878 et 1936 ont disparu. Un plan, dressé par le jardinier-chef en 1950, dessine l’emplacement de huit cent quatre-vingt-deux tombes avec une numérotation par année destinée à repérer la localisation nominative des sépultures. Il faut ajouter la tombe d’un aumônier (l’abbé Chesneau) et les tombes des religieuses, sept ? Trois cahiers successifs, tenus par le jardinier-chef puis le bureau des entrées, listent par année entre 1937 et 1992 les décès de l’hôpital psychiatrique et leurs sépultures : soit dans le cimetière de l’hôpital soit le corps est noté comme « emmené » , c’est-à-dire repris par les proches, soit exhumé secondairement, douze exhumations sont réalisées en mars 1949 à la demande de l’association des anciens combattants. Les sépultures sont de trois ordres : la majorité sont anonymes, une croix en béton armé, le temps a eu raison des croix en bois, porte une plaque numérotée avec l’année et le numéro du cahier (la plaque a souvent disparu), certaines peuvent être ornées de mobilier funéraire parfois avec le nom, croix métalliques, crucifix ou plaque mémorielle, ou alors une vraie tombe nominative financée par la famille est réalisée.
On peut découvrir à la lecture de ces cahiers l’évolution de certains usages. Le premier cahier entre 1937 et 1956 nomme l’institution Maison de santé de la Mayenne, à partir de 1973 c’est l’appellation Centre Psychothérapique qui apparait, remplacée en 1982 par Centre Hospitalier Spécialisé. Sur la période de 1937 à 1956 plus de cinq patients sur six sont enterrés dans le cimetière, sur la période suivante jusqu’en 1967 c’est la moitié qui seront inhumés en ville, les trois quarts jusqu’en 1984, les inhumations à l’hôpital jusqu’en 1992 deviennent alors peu fréquentes, 19%.
A partir de 1972 les tombes sont ornées de stèles en granit et ne sont plus anonymes.
Si vous souhaitez visiter le cimetière voir le guide de visite.