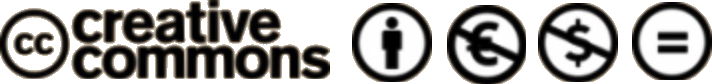Au xvii siècle la ville de Mayenne emploie deux archers dits « chasse-gueux » afin de faire respecter les édits contre la mendicité et de pousser les vagabonds hors de la ville ; le bureau de charité, chargé de distribuer les secours et de prononcer les admissions à l’hôpital, les appelle « serviteurs des pauvres ». Ils amènent les indigents éligibles à ce bureau : les pauvres pour être inscrits sur la liste des bénéficiaires de l’aide, doivent avoir plus de deux ans de domicile dans la ville, sont tenus de faire abandon de leurs biens au profit du bureau et de l’hôpital ; ceux qui dénoncent les biens cachés par les pauvres ont droit au tiers de ces biens à titre de récompense.
Les étrangers sont invités à se retirer dans leur paroisse d’origine, éventuellement après incarcération (un à trois jours selon l’époque).
Toute personne qui loge un pauvre, étranger à la localité, est responsable de sa nourriture et de sa subsistance. Au xviiie les propriétaires qui hébergent un "gueux" sont même punis d’une amende.
| Mémoire joint à la séance du 21 novembre 1787 de l’assemblée des trois provinces de la généralité de Tours . | ON A POUR DÉTRUIRE LA MENDICITÉ : 1- des maisons de force 2- des défenses de mendier 3- de l’emprisonnement 4- des bureaux de Charité, formés par la bienfaisance de quelques citoyens, et en trop petit nombre, pour l’étendue du royaume. L’expérience a démontré que le dernier de ces moyens est le seul qui ait réussi. La raison est bien simple : c’est qu’il est le seul qui tende à la réformation des mœurs par le travail, le seul qui soit fondé sur la religion et la morale. |
FONDATEURS, BIENFAITEURS ET SPOLIATEURS DE L’HÔPITAL
Les hôpitaux médiévaux et modernes prérévolutionnaires sont construits et fonctionnent grâce aux legs et donations de biens fonciers et de rentes.
Plusieurs donateurs du xviiie dotent l’hôpital pour que des lits soient accessibles aux nécessiteux des communes alentour leur évitant la rigueur des règlements anti-mendicité.
LES SPOLIATEURS VOIENT CERTAINES DE LEURS TENTATIVES ÉCHOUER
1555 Une ordonnance considère que les aumôneries, hôtels et maisons-Dieu et autres lieux pitoyables sont de plein droit à la disposition du roi. L’inventaire présenté par les administrateurs proteste de ce droit et constate plus de dettes comblées par les donateurs que de bénéfice potentiel pour le roi.
Les hospitaliers du Saint-Esprit d’Auray prétendent à plusieurs reprises avoir des droits sur l’Hôtel-Dieu en 1663 et 1717 ; l’aumônier défend l’indépendance de l’hôpital en montrant son ancienneté et la spécificité de sa fondation reposant sur les bourgeois de la ville.
1760 Le roi ferme le couvent-hospice de la Madeleine, ses biens reviennent aux dominicaines du Maillet au Mans.
Les mayennais obtiennent de conserver les bâtiments du couvent et le pré de la Madeleine pour permettre la fondation d’un hôpital général.
À la révolution, la nation vend les biens et rentes de l’hôpital qui doit fortement réduire son activité à cause de la baisse de ses revenus. Les mayennais obtiennent cependant que l’hôpital général de la Madeleine et le pré de la Madeleine ne soient pas vendus en regard des services rendus par l’institution.